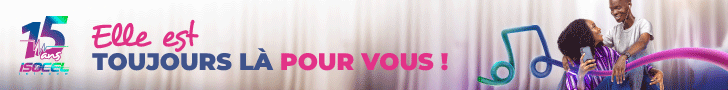Célébration des prémices de l’igname : Les orientations du Hounnongan Dègbédji
La sortie des nouvelles ignames au cours du mois d’août coïncide souvent avec la résurgence des cas de maladies et aussi de décès inattendus au sein des communautés. Pour conjurer ce mauvais sort, il faut nécessairement célébrer les nouvelles ignames avant leur consommation. Ceci, en faisant une offrande à base de la nouvelle igname, notamment la variété ‘’Labôkô’’, aux divinités.
L’igname encore appelée ‘’Tévi’’ en langue fongbé est un tubercule pas comme les autres. Bien qu’il soit l’un des aliments les plus prisés au Bénin, il est un symbole cultuel et culturel en terre Mahi. Puisque sa récolte cadre la plupart du temps avec des cas de maladies, il fait alors l’objet un rituel sacré voué aux divinités où elle est bénie, cuisinée et partagée, histoire d’implorer leurs bénédiction et protection sur les familles. « Lors du onzième mois lunaire, on note une forte prévalence des maladies avec à la clé, des morts subites, du fait que les feuilles qui servent dans les différentes cautions de guérison des maladies vont à Fê et deviennent du coup, inefficaces. Pour déjouer les pronostics, les sorciers s’attaquent dans le treizième mois qui coïncide avec la sortie de la nouvelle igname. Ceux qui banalisent ces rituels dans leurs familles font les frais de leur entêtement. D’où des morts inattendues», explique Hounnongan Hossou Dègbédji Gbèdiga Ahissitchè Mètôgnimabou Sèwèsô. Au-delà de son aspect cultuel, d’autres peuples le célèbrent comme étant un trait d’union entre les filles et fils d’une même aire culturelle. C’est le cas par exemple du 15 août à Savalou, date au cours de laquelle Dada Ganfon Gbaguidi XV autorise officiellement la consommation des nouvelles ignames en offrant d’abord celles-ci à son Fâ et aux divinités connexes du royaume de Axossou Soha. Mais attention ! « La fête de 15 août des savalois ne suffit pas pour autoriser la consommation de l’igname dans tout le Bénin », fait remarquer le Hounnongan Hossou Dègbédji. Dans le royaume de Danxomè, c’est plutôt l’apparition de ‘’Katahounto’’, c’est-à-dire des vodounsi des souverains au temple Aïzan du marché Houndjro qui lance les hostilités. Chaque collectivité, chaque famille ou chaque chef de couvent est autorisé à organiser le rituel de ‘’Tédoudou » ou d’offrande de la nouvelle igname aux divinités de leur clan.
Au-delà de l’aliment, l’igname est un fruit d’exception
«Elle est particulière au regard du temps qu’elle passe sous la terre avant de murir. Elle fait neuf mois sous terre tout comme l’homme au sein de sa mère. Raison pour laquelle, elle est célébrée à chaque récolte. On l’accueille, on lui rend hommage le servant aux divinités avant que le commun des mortels ne le consomme. On le fait pour briser les liens que les sorciers ont souvent avec ce tubercule qui leur sert de tremplin pour atteindre leurs cibles », explique-t-il. En principe, poursuit le Hounnongan Hossou, le ‘’Tédoudou » devrait concerner tout le monde dans la mesure où chacune des familles est fondée sur une ou plusieurs divinités qui assurent la garde. Il faut donc leur rendre hommage et leur témoigner la gratitude. Il s’agit notamment du Fâ, du Lègba, de tous les vodoun Hounvê, du Thron Kpéto Déka, etc. Malheureusement, le christianisme et l’islam ont changé le cours des choses au point où beaucoup renoncent à leur tradition. Ce qui justifie la persistance des malheurs dans la société en dépit des rituels qui se font çà et là par certaines familles et chefs de couvent. Vu donc la sensibilité de la nouvelle igname au sein de la tradition, à la période de récolte de celle-ci, les adeptes des différents couvents et initiés aux pratiques cultuelles, s’interdisent de consommer le tubercule parce que ne pouvant distinguer sur le marché, l’ancienne récolte de la nouvelle. La crainte est d’en prendre dans les premières moissons de l’année. Outrepasser ce principe est un sacrilège dont les sanctions vont jusqu’à la mort, selon le Hounnongan Hossou Dègbédji, prêtre du Thron Kpétodéka à Hêzonho, Bohicon. Chaque dignitaire de culte et chef de collectivité est alors tenu d’organiser le plus tôt possible, le rituel de la nouvelle igname afin d’éviter les malédictions à leurs membres. « Moi, au niveau de mon couvent, j’ai déjà sacrifié à cette tradition à laquelle l’on ne peut se soustraire puisqu’elle dénote de notre identité », fait savoir Hounnongan Hossou Dègbédji. Lors du rituel, la nouvelle igname est uniquement utilisée et non l’ancienne. « N’importe quelle igname ne sert pas dans le rituel. Seule la variété ‘’Labôkô’’est recommandée », insiste Hounnongan Hossou Dègbédji, président de la fondation « Gbèdiga » pour qui l’usage d’autres variétés pourrait attirer la colère des divinités.
Le Vodoun ne doit pas être une source de revenu
« Le vodoun est une croyance ancestrale et non une activité génératrice de revenu », relève le Hounnongan Hossou Degbédji. Selon lui, un dignitaire de culte, au risque d’asphyxier ses adeptes ou ses clients, doit avoir parallèlement à ses activités spirituelles qui sont d’ailleurs secondaires, des activités principales. Cela épargne le prêtre du Vodoun des pièges de la cupidité et du rançonnement et de pouvoir respecter les principes de la tradition. «Le vodoun nous recommande de travailler et ce n’est que par le travail qu’il pourra nous bénir », soutient-il. Il a alors exhorté ses pairs à se donner d’autres activités afin de corriger l’image que les gens font des prêtres de culte traditionnel et de préserver l’héritage Vodoun. La fondation Gbèdiga, l’association Codath, Houindonafa et Asnades travaillent dans ce sens pour redorer l’image du Vodoun au Bénin.
Zéphirin Toasségnitché (Br Zou-Collines)