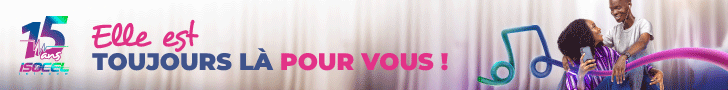Sous-total : 100 CFA
Poterie dans le département du Zou : Agbangnizoun, une source minière dans la paupérisation
Agbangnizoun, l’une des neuf Communes du département du Zou, dispose d’un important gisement d’argile, un atout minier qui, s’il était valorisé, devrait lui permettre de s’affranchir et d’accroître ses ressources propres au profit du bien-être collectif de sa population. Malheureusement, c’est le paradoxe qui se produit dans la cité des antilopes. En l’absence d’une gestion rigoureuse et règlementaire, une minorité en profite au détriment de la grande masse. Ce qui constitue pour les caisses de la Commune, une fuite de capitaux. Les autorités locales ne font rien pour mettre en valeur cette ressource naturelle.
«Dans toutes les Communes du Zou, l’indice humain de pauvreté a baissé sauf dans la Commune d’Agbangnizoun où, il est passé de 42% en 2002 à 51% en 2013 », illustrent les résultats d’une enquête de l’Institut national de la statistique et de la démographique (Instad). Autrement dit, la terre bénie d’antilopes ne profite pas du tout de sa ressource minière. Bien au contraire, elle s’enlise dans la pauvreté. Et pour cause. Dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres d’Abomey, l’extraction de l’argile est une vieille activité en cours depuis 1990. Elle alimente le secteur de l’artisanat avec un fort peuplement d’acteurs qui s’investissent dans la poterie et la fabrication des objets d’art à partir de l’argile. L’exploitation des carrières argileuses contribue qu’on le veuille ou non, à l’amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, elles ne sont pas pour autant épanouies, car leur bien-être ne cesse de se dégrader. Sur la carrière de Loukpé, un village de l’arrondissement de Sahè, c’est tout un désordre. Les extracteurs, sans formation de base, n’ont pris aucune notion d’hygiène et environnementale. Ils se préoccupent même très peu de l’épuisement de cette ressource non renouvelable et des dommages qu’elle laisse à l’environnement. Leur but ultime se limite seulement au revenu immédiat à tirer quel que soit le coût social et le prix environnemental. Les populations riveraines, quant à elles, subissent chaque jour l’assaut de la masse poussiéreuse qui se répand dans la nature, dans les chambres, les casseroles et autres ustensiles, entraînant du coup de graves ennuis de santé.
Extraction et commercialisation de l’argile à l’état brut
Sur le terrain, deux groupes d’exploitants miniers travaillent en symbiose. Il y a l’équipe des extracteurs et celle des ramasseurs. Les éléments de la première n’ont pas eu besoin de gros moyens avant d’extraire l’argile de façon traditionnelle dans des galeries de plus d’un mètre de profondeur sur des terrains privés dont les propriétaires se font rétribuer. Sur les sites généralement à ciel ouvert, ils se servent alors de leurs outils rudimentaires, une technique qui consiste à creuser à l’aide de houes, pelles, coupe-coupe, pioches etc.. Ils forment des tas d’argile prêts à être convoyés vers les points de vente. C’est alors que ceux qui s’occupent du ramassage et se mettent au travail. Au moyen de leurs bassines, de vélos et de leurs tricycles, ils assurent le transport de la matière première vers le domicile des céramistes clients et de ceux qui expriment la demande. Une activité de grande pénibilité, ceux-ci n’ont pas d’autre choix que de se résigner. «Nous n’avons pas appris un métier. Mais nous devons survire. Quoi qu’il advienne, il faut résister et la providence divine se chargera du reste », a laissé entendre l’une des ramasseuses gémissant sous le poids de l’argile transportée dans une bassine. A quelques pas de celle-ci, un jeune homme, le corps recouvert de sueur, ploie sur la charge portée par son vélo qu’il traîne. Ceux qui utilisent des tricycles ne subissent pas des sévices physiques, mais le moteur de leur engin en pâtit. En dépit de ces difficultés qui s’ajoutent à l’état dégradé de la voie, la matière atteint sa destination. L’argile brute ainsi prélevée est vendue aux potiers suivant une mesure. «L’unité de mesure est constituée d’une charge de 75 kg répartie dans deux sacs dont un sac devant et l’autre derrière sur le vélo. Le coût de cette charge varie selon la distance qui sépare l’acheteur, de la carrière. Ainsi, le prix d’un sac oscille entre 900 et 1 500 FCfa. Cette charge de 75 kg constitue la charge maximale qu’un transporteur peut supporter au cours d’un voyage », renseigne Séraphine Bossikponnon, une potière en quête d’argile sur la carrière de Loukpé. Elle ajoute que les convoyeurs livrent le produit à leurs clients traditionnels. Etant une débutante dans le secteur, elle n’a pas encore de partenaire fixe. Ce qui l’oblige à se déplacer sur le site pour négocier. Le fordisme ainsi crée procure aux populations qui s’y investissent, des revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins quotidiens. «L’agriculture n’est plus rentable pour nous. Aujourd’hui, c’est l’exploitation de l’argile qui nous nourrit », témoigne Martine Tohan. «Sans cette ressource, on ne pourra pas gérer les charges des enfants et celles de la famille », renchérit Raymond Agbamahou.
Tout pour la minorité rien pour la Commune
Si les extracteurs s’accordent que l’exploitation de l’argile renforce le tissu social dans la Commune et contribue à la réduction des fléaux sociaux tels que le vol, l’exode rural, l’insécurité, le trafic des enfants, les caisses de la Commune n’en tirent pas cependant grand profit. Or, la création de la richesse dans une localité donnée est relative à l’exploitation de ses ressources locales. Situant les causes à deux niveaux, Frédéric Gbagbonon, leader traditionnel indique que ces différents gisements d’argile sont, d’une part mis en valeur de façon artisanale et d’autre part, leur gestion pose un véritable problème. «Lorsque les ressources naturelles sont gérées efficacement, la commune pourra avoir au moins le minimum de ressources financières pour son fonctionnement», insiste-t-il. Il regrette alors la passivité des autorités locales qui, selon lui, ne font rien pour promouvoir cet héritage. S’agissant de la contribution de l’exploitation de l’argile au budget communal, il faut noter qu’aucune statistique officielle relative à l’apport financier de cette ressource dans le budget communal n’est disponible. A en croire les confidences d’un agent du service de recouvrement qui a requis l’anonymat, la mairie n’effectue aucun recouvrement sur l’exploitation de l’argile dans la commune. Des propos que confirme le chef de l’arrondissement de Sahè. «Nous ne percevons rien, même pas un copeck sur l’exploitation des carrières d’argile », martèle-t-il. En attendant la mise en branle des réformes en cours dans le secteur, l’arrondissement de Sahè, bien avant le régime de la rupture, avait pris en charge l’exploitation des carrières, ce qui lui rapportait des revenus relativement importants à la Commune. «Avant, nous payons à la Mairie une taxe forfaitaire de 500 FCfa par semaine », a reconnu Bernadette Houdji, une extractrice d’argile à Sahè. Malheureusement, l’incivisme fiscal des populations n’a pas permis à la Mairie de faire une bonne rentabilité pour la réinvestir dans les actions de développement de la Commune. Face à ces réalités, la rationalité de ce gisement s’impose aussi bien pour la sauvegarde de l’environnement que pour l’émergence économique de la Commune. Il urge donc de chercher à améliorer l’exploitation de cette ressource naturelle en l’inscrivant dans une option de développement durable.
Transformation de l’argile
De l’exposé de Martine Tohan, transformatrice, l’argile ramenée de la carrière, suit trois grandes étapes pour sa transformation. Emiettée puis séchée aux rayons solaires, elle est ensuite délayée dans l’eau contenue dans des jarres. C’est le trempage. Cette première étape permet de ramollir l’argile pour faciliter sa manipulation. Elle dure deux jours. Par la suite, l’argile est pétrie avec la main ou avec les pieds. Une première pâte apparaît. Celle-ci est progressivement aspergée d’eau jusqu’à l’obtention d’une seconde pâte très élastique. Une fois la pâte obtenue, la potière commence la fabrication d’un objet potier par façonnage. Les objets fabriqués sont exposés au soleil jusqu’au lendemain. Ensuite, vient leur modelage suivi de leur polissage qui acquiert sa forme définitive. Il se fait au moyen de galet uni et d’une petite bande de tissu moyen que l’on passe délicatement sur toute sa surface externe. Après cette étape de fabrication, suivent respectivement le séchage qui dure une semaine, et la cuisson des produits fabriqués sur ‘’Abita’’ où est installée la fournaise. Ce processus consiste à rendre plus solides les objets façonnés à l’aide du feu. À l’issue de la cuisson, plusieurs produits finis sont obtenus : les foyers, les marmites, les caisses à sous, les statuettes, la jarre trouée, les canaris etc. Ces objets sont décorés et sont marqués par des couleurs rouge, blanche et parfois noire selon le goût de la transformatrice.
Zéphirin Toasségnitché (Br Zou-Collines)
 Le Matinal du 05 septembre 2022
Le Matinal du 05 septembre 2022